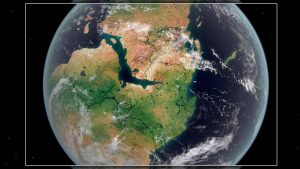Après quarante-trois ans passés sur les routes à transporter des marchandises dans les quatre coins de la France et de l’Europe, j’ai finalement posé les clés de mon camion. Une page s’est tournée et avec elle commence une nouvelle étape : la retraite.
Beaucoup se demandent quel est la pension d’un chauffeur routier après une carrière entière. Voici un aperçu concret de ma situation et des mécanismes qui déterminent le montant de cette retraite.
Le montant réel d’une retraite de routier en 2025
Aujourd’hui, ma pension mensuelle est de 1 187 euros. Ce chiffre correspond à la moyenne observée en 2025 pour les anciens conducteurs de poids lourds. Le montant peut sembler limité après une vie de travail, mais il repose sur plusieurs critères précis.
Trois éléments principaux entrent en jeu dans le calcul :
- le nombre total d’années de service validées ;
- la moyenne des salaires des 25 meilleures années ;
- le régime de cotisation, auquel peuvent s’ajouter des périodes effectuées en indépendant.
Dans mon cas, j’ai validé 42 années de cotisation et cela m’a permis d’obtenir une pension relativement stable. Chaque trimestre a compté dans ce calcul, d’où les différences parfois importantes entre collègues ayant pourtant exercé le même métier.
Pour donner un ordre d’idée, voici une comparaison selon l’ancienneté :
| Années de service | Pension moyenne mensuelle |
| 30-35 ans | 950 € – 1050 € |
| 36-40 ans | 1050 € – 1150 € |
| 41-45 ans | 1150 € – 1300 € |
Ces chiffres montrent clairement que la durée de carrière influe directement sur le montant final.
Les dispositifs spécifiques au métier de routier
L’âge moyen de départ à la retraite pour un chauffeur routier se situe autour de 64 ans. Toutefois, il existe des dispositifs particuliers permettant un départ anticipé.
Le plus connu est le CFA (Congé de Fin d’Activité) instauré dans les années 1997-1998. Ce dispositif m’a permis d’arrêter avant l’âge légal, tout en conservant un revenu correct.
Pour en bénéficier, il fallait justifier d’au moins 26 ans dans le transport de marchandises. Son calcul s’appuie sur la moyenne brute des douze derniers mois de salaire, ce qui rend la transition vers la retraite plus progressive.
C’est une manière de reconnaître les conditions de travail parfois difficiles : longues journées, horaires décalés et contraintes physiques importantes.
L’importance des compléments de pension
La pension de base n’est pas la seule source de revenus. Les régimes complémentaires comme l’Agirc-Arrco apportent une part essentielle au revenu final. Sans eux, l’équilibre budgétaire serait beaucoup plus fragile.
De mon côté, j’ai aussi choisi de souscrire à un plan d’épargne retraite volontaire dans les dernières années de ma carrière. Ces économies me servent aujourd’hui de sécurité pour affronter les imprévus du quotidien : réparations, dépenses de santé ou encore petits plaisirs familiaux.
Pour les collègues qui ont exercé comme indépendants, la situation est plus variable. Le montant de leur pension dépend directement des cotisations qu’ils ont versées.
Le statut d’auto-entrepreneur, souvent attractif, exige une gestion rigoureuse pour éviter de se retrouver avec une retraite trop faible.
Bilan d’une carrière sur la route
Avec mes 1 187 euros mensuels, je parviens à vivre correctement. Je n’ai pas de luxe, mais suffisamment pour profiter sereinement de cette nouvelle étape. Certes, le métier a été exigeant, parfois éprouvant, mais il m’a offert une vie stable et une pension honorable.
Le travail des routiers est essentiel. Sans eux, la logistique et l’approvisionnement du pays seraient paralysés. C’est une fierté qui accompagne ma retraite et donne du sens à toutes ces années passées derrière le volant.