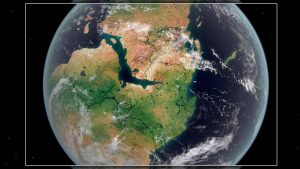La pension de réversion est une aide versée au conjoint survivant après le décès d’un assuré et elle pourrait bientôt changer de visage. Une réforme prévue pour début 2026 promet d’uniformiser, clarifier et rendre plus juste ce système souvent jugé compliqué et inégal.
Conditions d’éligibilité, calcul des montants, règles différentes selon les régimes, tout est sur la table. Si vous touchez ou espérez toucher cette pension, mieux vaut comprendre les changements qui s’annoncent.
Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ? On fait le point.
Une ouverture possible aux couples non mariés
Aujourd’hui, la pension de réversion est réservée aux conjoints mariés selon la durée du mariage. Mais les choix pourraient évoluer.
Le gouvernement envisage d’étendre l’accès aux couples pacsés ou en concubinage pour mettre fin à une inégalité juridique qui commence à paraître dépassée. La société évolue et la loi pourrait la suivre.
De plus, la règle agaçante de l’Agirc-Arrco qui supprime les droits en cas de remariage serait abandonnée. En conséquence, plus de veufs et de veuves pourraient bénéficier de la pension, quelle que soit la nature de leur union.
Une bonne nouvelle pour beaucoup !
Un plafond de ressources harmonisé
Autre point sensible : le plafond de ressources. Aujourd’hui, chaque régime (privé, public, indépendant) a ses propres critères, souvent différents et difficiles à comparer. La réforme prévoit un plafond unique, clair et identique pour tous.
Cette simplification administrative devrait mettre fin à de nombreuses disparités. Sur le plan financier, cela pourrait profiter à certains, mais en faire perdre d’autres si le nouveau plafond est plus strict.
Un âge minimum unique pour tous
L’âge minimum pour toucher la pension varie lui aussi selon les régimes : 55 ans dans le régime général, aucun âge dans la fonction publique et cela crée des inégalités. Le nouveau projet vise à fixer un âge commun, probablement entre 55 et 60 ans.
Cette mesure a pour but d’harmoniser le système et de réduire ces différences incompréhensibles. Certains devront donc patienter un peu plus avant d’en bénéficier. Le calendrier des droits risque d’être modifié.
Calcul de la pension : vers plus d’égalité… ou pas ?
Le calcul de la pension est aujourd’hui différent d’un régime à l’autre : 54 % du montant pour la Sécurité sociale, 50 % pour la fonction publique. La réforme propose un taux unique compris entre 50 % et 60 %.
Ce serait plus simple, mais selon le taux retenu, certains ménages fragiles pourraient y perdre. Un taux à 60 % serait favorable, un taux plus bas risquerait de pénaliser des familles déjà fragiles.
Trouver le bon équilibre entre équité et solidarité n’est pas une mince affaire.
Double proratisation : un calcul plus juste… mais complexe
Une autre idée en débat est la double proratisation. Cela signifie que le montant de la pension dépendrait de la fois de la durée de cotisation du défunt et de la durée du mariage. Ce serait plus juste et personnalisé mais aussi risqué.
Les conjoints d’unions courtes ou de carrières modestes pourraient y perdre. C’est une épée à double tranchant qui complique le calcul mais reflète mieux la réalité des parcours.
Une formule « à la suédoise »
Enfin, une formule inspirée de la Suède est évoquée. Il s’agit de l’attribution de deux tiers de la pension du défunt, moins un tiers de la retraite personnelle du survivant.
Cette méthode vise à garantir un revenu global stable, tout en prenant en compte les ressources individuelles. C’est plutôt malin, mais cela pourrait réduire les compléments pour ceux qui ont une petite retraite, un point à surveiller.